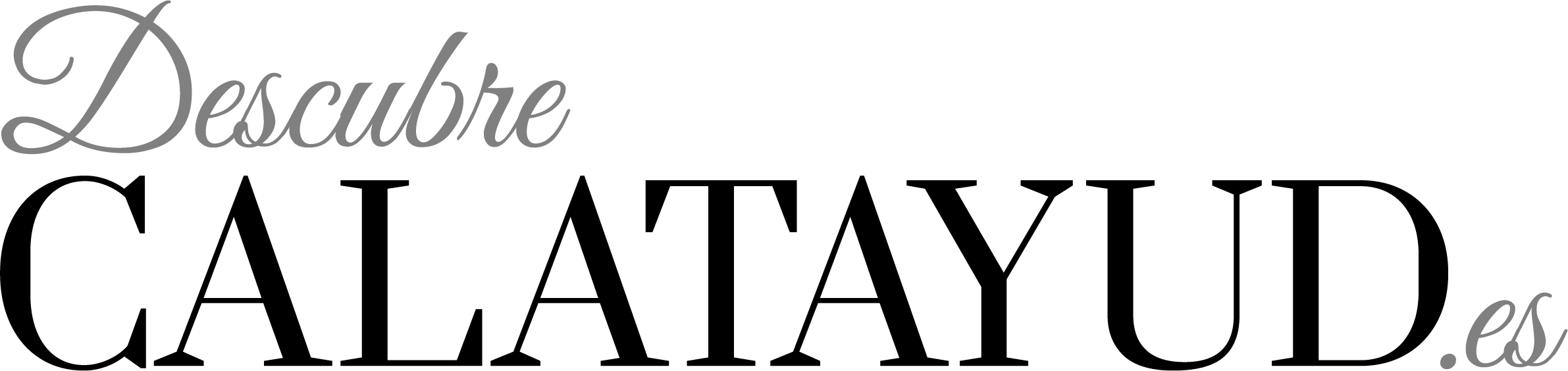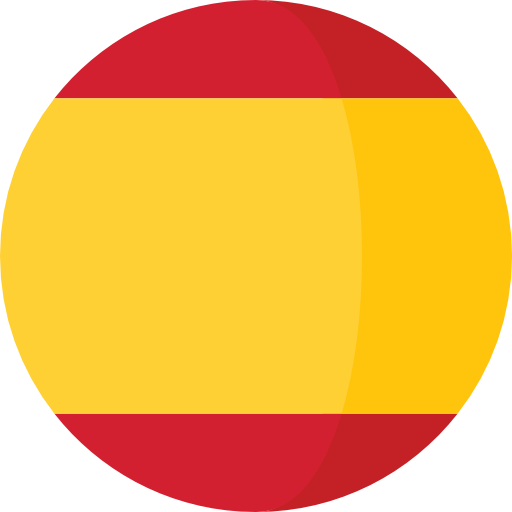14. Chapelle du Saint-Christ




14. Chapelle du Saint-Christ
La chapelle du Saint-Christ, également connue sous le nom de chapelle de la famille Peralta Forcén Bernabeu del Castillo, est un exemple architectural notable situé à la base du clocher de l’église collégiale de Santa María. Sa structure est intégrée dans le fût inférieur de la tour, qui suit une conception similaire à celle de l’église de San Andrés, avec une configuration de tour extérieure et de contre-tour intérieure. Cette dernière repose sur une casemate d’approche construite avec des assises de briques, créant un espace octogonal à sa base. Il est important de noter que l’accès à la tour est surélevé par rapport à cette casemate.
L’histoire récente de la chapelle marque un tournant en 1973, lorsque la voûte originale en briques qui dissimulait la casemate en briques a été enlevée. Les documents photographiques antérieurs à cette date montrent que la voûte et les huit murs de la chapelle étaient recouverts d’un enduit élaboré de style baroque, et que l’espace était dominé par un magnifique retable du XVIIIe siècle, caractérisé par des colonnes solomoniques et un Christ crucifié. Lors des travaux de consolidation de la Collégiale, l’architecte-restaurateur a pris la décision d’enlever toute la décoration baroque, la jugeant incompatible avec l’origine mudéjar de la tour. Cette intervention incluait le démontage du retable, ne conservant que l’image du Christ crucifié. Lors de la dernière restauration, compte tenu de l’impossibilité de retrouver l’aspect original, il a été décidé de recouvrir les murs d’albâtre.
L’accès à la chapelle se fait par un arc en plein cintre, situé dans le chœur du côté de l’Épître, faisant partie d’une porte qui trouve son reflet symétrique dans la chapelle de la Solitude, située du côté de l’Évangile. La décoration du portail présente un riche programme ornemental baroque qui comprend des pilastres corinthiens, des frontons cintrés, des motifs végétaux, des masques et des cornes d’abondance. On remarque également les anges qui soutiennent la colonne de flagellation et la Sainte Croix, un pélican eucharistique et les armoiries héraldiques des patrons, qui ont fait de cet espace leur lieu de sépulture à partir de 1615, d’après une inscription.