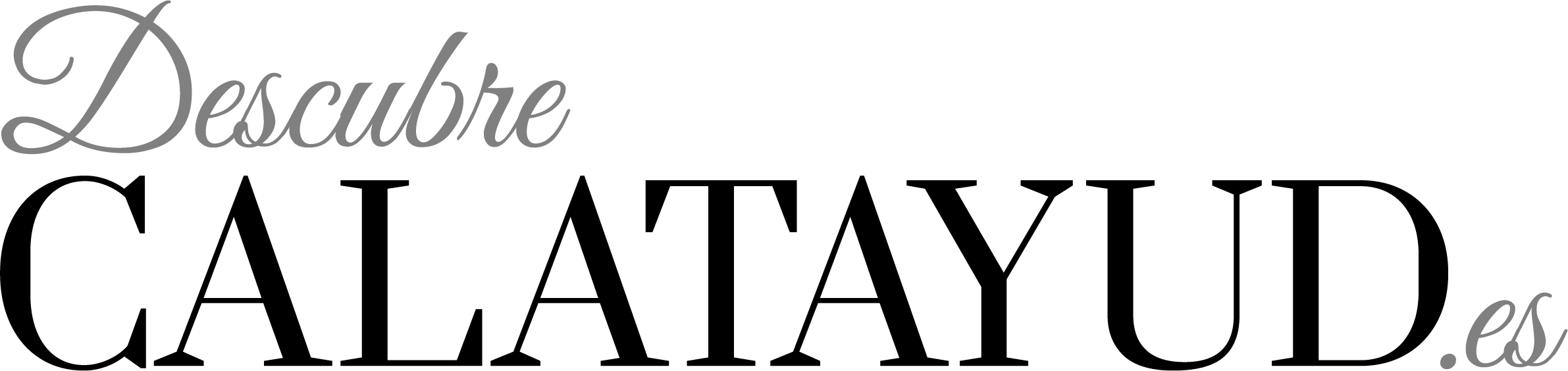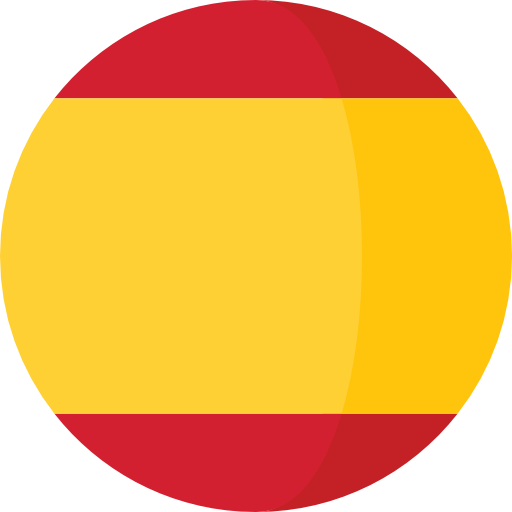17. La tour et l’abside mudéjar, classées au patrimoine mondial de l’humanité





17. La tour et l’abside mudéjar, classées au patrimoine mondial de l’humanité
La Collégiale de Santa María a reçu d’importantes récompenses qui confirment sa valeur historique et artistique exceptionnelle. Elle a été déclarée monument national en 1884, puis bien d’intérêt culturel en 1985, et enfin sa tour, son abside et son cloître ont reçu la plus haute distinction en tant que site du patrimoine mondial en 2001. Ces trois éléments médiévaux ont conservé leur identité architecturale bien qu’ils aient été intégrés au temple construit au XVIIe siècle et qu’ils aient subi diverses extensions au cours de son histoire.
D’un point de vue typologique, la tour de Santa María de Calatayud est classée parmi les tours dérivées du minaret hispano-musulman, caractérisée par sa structure en deux tours octogonales concentriques avec l’escalier situé dans l’espace intermédiaire. Contrairement à d’autres tours mudéjares où le contrefort central part de la base, à Santa María ce noyau repose sur une voûte robuste par approximation de cours, ce qui permet d’utiliser l’espace inférieur comme chapelle accessible depuis l’intérieur de la Collégiale.
La tour a été conçue en parfaite correspondance avec l’abside, et il est probable que les deux éléments ont commencé à être construits simultanément au début du XVe siècle. Cette correspondance est évidente dans la décoration identique du premier corps de la tour et du premier tronçon de l’abside : chaque tronçon comporte une fenêtre aveugle en arc brisé, au-dessus de laquelle se trouvent trois frises de briques d’angle, des clous qui évoquent vaguement le motif des échecs et des motifs géométriques de lames entrelacées, typiques de l’architecture mudéjare.
La tour d’origine ne dépassait probablement pas le deuxième niveau d’ouvertures, hauteur à laquelle se trouvait peut-être le premier corps de cloches. Peu de temps après, elle a été reconstruite, une intervention qui a peut-être inclus la construction de l’escalier accessible depuis le cloître.
Au cours du XVIe siècle, la tour médiévale a fait l’objet d’un nouvel agrandissement pour surélever le clocher, ce qui pourrait avoir eu lieu à la fin du XVe siècle ou à la suite de l’élévation de l’abside et de la rénovation de la chapelle principale. Les murs extérieurs ont été décorés de bandes de briques en relief formant des losanges ou des motifs de sebka. En même temps, l’abside a été agrandie d’une travée supplémentaire dont le nombre de travées a été réduit de sept à quatre, réparties en deux sections : dans la section inférieure, une fenêtre en plein cintre avec trois archivoltes par travée a été ouverte, tandis que dans la section supérieure, il y avait trois arcs en plein cintre avec deux archivoltes, réunis par une saillie à la hauteur des impostes et décorés de frises de pastilles et de briques d’angle.
À la fin du XVIIe siècle, des années après l’achèvement de l’église actuelle, les deux dernières sections couronnant la tour ont été ajoutées. Plus tard, au cours du XVIIIe siècle, on a installé la flèche bulbeuse d’esthétique baroque, qui repose sur un tambour perforé d’oculi et s’appuie sur une solide structure en bois recouverte de plomb.
La cage d’escalier mesure environ un mètre et demi de large, avec quatre marches par volée. Les marches sont recouvertes d’assises de briques, une par volée, d’une hauteur de dix assises et de forme trapézoïdale. Exceptionnellement, les dernières sections sont couvertes de voûtes en berceau.